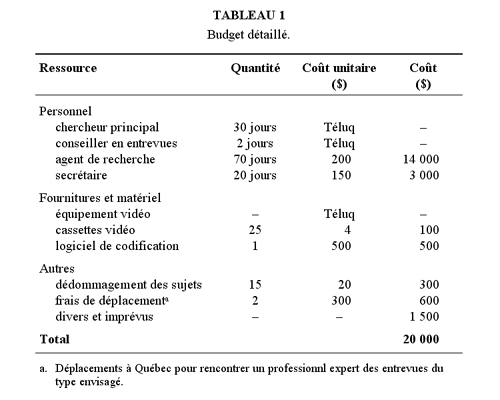|
Exemple de devis de
recherche
Cet exemple de devis de recherche correspond
à ce qu'on retrouverait dans une demande de
financement pour un projet de recherche universitaire de
type fondamental dans le domaine des sciences de
l'information et de la communication.
Pour d'autres types de recherche
(appliquée, recherche-développement) et de
contexte de financement (commandite, recherche en
partenariat avec l'entreprise), certaines sections
pourraient être plus détaillées. Ainsi,
on pourrait exiger de chiffrer la contribution de
l'établissement, de fournir plus de détails
sur l'expérimentation, les compétences ou le
rôle des personnes travaillant au projet, les
réalisations ou produits résultant du projet
et la propriété intellectuelle sur
ceux-ci.
|
|
Les simulations sont utilisées depuis
de nombreuses années dans l'enseignement,
particulièrement dans les disciplines scientifiques.
L'augmentation de la puissance de traitement et d'affichage
des ordinateurs personnels et le développement de
logiciels permettant l'accès en ligne à des
applications sophistiquées (applets Java,
réalité virtuelle) ont largement
contribué à l'essor de ce champ
d'activité.
Certaines de ces simulations reproduisent, de
manière plus ou moins réaliste et
détaillée, des expériences de
laboratoire; on les qualifie alors souvent de
« laboratoires virtuels ». Ce terme,
d'usage assez récent, recouvre en fait une large
gamme d'applications et d'environnements grâce
auxquels les usagers accomplissent des tâches
semblables à celles que l'on effectue en laboratoire.
Les laboratoires virtuels visent à compléter,
voire remplacer dans certains cas, les expériences
réelles, par exemple quand celles-ci exigent un
appareillage trop coûteux ou présentent des
risques pour les apprenants (Budhu, 2002).
Compte tenu des coûts importants
associés au développement de simulations, il
est essentiel de prendre les mesures nécessaires pour
en assurer la qualité et la valeur
pédagogique. À ce sujet, Hennessy et O'Shea
(1993) indiquaient que les concepteurs de simulations
devraient accorder une grande importance à la
crédibilité de celles-ci, tant pour en assurer
la valeur pédagogique que pour disposer de principes
solides sur lesquels fonder leur design. On comprendra que
cette crédibilité, que l'on peut
définir comme la perception de la capacité
d'une simulation d'assurer l'atteinte des objectifs qu'elle
annonce et de la fiabilité des informations qu'elle
présente, est particulièrement importante dans
le contexte de l'apprentissage à distance, où
les simulations représentent un des principaux, sinon
le seul moyen pour les apprenants d'effectuer des
activités de type expérimentation.
Les auteurs soulignaient par ailleurs que
cette question avait été très peu
étudiée et méritait amplement qu'on y
accorde davantage d'attention. Or, force est de constater
que, depuis, seuls quelques travaux, dont les deux
études précitées (Hatzipanagos, 1995;
Edward, 1997) ont abordé ce sujet, et souvent de
manière partielle.
Des travaux récents (Tseng et Fogg,
1999a) montrent que plusieurs facteurs influencent la
crédibilité d'une application; mentionnons la
réputation des auteurs ou des fabricants, l'opinion
des pairs, de même que les caractéristiques et
le comportement de l'application elle-même. Pour le
cas spécifique des simulations, comme le soulignent
ailleurs les mêmes auteurs (Tseng et Fogg, 1999b), le
réalisme, ou plutôt la perception de
réalisme (appelée vraisemblance),
constituerait un facteur particulièrement
important.
Chez les usagers, cette perception s'exprime
principalement sous la forme de jugements de vraisemblance.
Ces jugements, fondés sur divers critères
(Elliott, Rudd et Good, 1983; Chandler, 1997), sont le plus
souvent liés à des caractéristiques de
l'environnement ou à des repêres perçus
par les usagers (Hatzipanagos, 1995; Edward, 1997).
Une étude portant sur la
crédibilité d'un laboratoire virtuel,
fondée sur une analyse des jugements de vraisemblance
des usagers s'avère donc pertinente.
|
|
L'environnement qui sera employé pour
l'étude est le laboratoire virtuel de physique (LVP)
développé au cours des deux dernières
années par le responsable de ce projet. Il s'agit
d'un environnement informatique visant, par la simulation
d'expériences, l'apprentissage de la démarche
expérimentale en physique. Il offre également
des explications sur les concepts et lois utilisés
pour décrire et expliquer les
phénomènes en cause dans les
expériences simulées.
Le LVP se prête particulièrement
bien à une étude sur les perceptions des
usagers en matière de vraisemblance. En effet, dans
le but de favoriser sa crédibilité
auprès des apprenants, il a été
développé selon un principe de design
axé sur le réalisme qui a influencé
l'ensemble de ses caractéristiques.
Compte tenu du caractère exploratoire
de la recherche, une approche qualitative, comprenant des
entrevues semi-dirigées approfondies, sera
adoptée. Une quinzaine de participants
représentatifs de la clientèle
envisagée du LVP seront recrutés sur une base
volontaire pour participer à la recherche. On fera
appel à des étudiants ayant déjà
suivi des cours à distance mais cette exigence sera
abandonnée si elle empêche d'atteindre le
nombre de participants requis.
Au cours de sessions individuelles, les
participants devront effectuer, guidés par le
superviseur, une série de tâches typiques ce
celles qu'un étudiant effectuerait dans une des
expériences simulées offertes par le LVP. Ces
tâches amèneront les participants, dans le
contexte d'une entrevue semi-dirigée, à
visiter l'environnement du LVP, à utiliser la plupart
des outils et à accéder aux diverses
ressources qui le composent. Les entrevues seront
menées à l'aide d'un canevas assez souple
destiné à favorisant l'expression des
jugements des participants.
L'expérimentation se déroulera
au laboratoire LORIT de la
Télé-université. Celui-ci offre toutes
les fonctionnalités permettant d'enregistrer et
d'analyser tant les gestes des participants que le contenu
des écrans. Une demande de réservation d'une
plage de 60 heures en avril 2005 a déjà
été effectuée (voir annexe).
Le canevas d'entrevue, ainsi que toute la
logistique de l'expérimentation, seront
validés au cours d'une
pré-expérimentation effectuée avec deux
personnes jouant le rôle de participants,
sollicitées à l'interne.
Les entrevues seront transcrites, puis
codifiées à l'aide d'un logiciel
spécialisé. Les résultats feront
l'objet d'une analyse qualitative, sans recours aux
statistiques, et seront présentés dans un
rapport de recherche.
L'agent de recherche effectuera l'ensemble
des tâches reliées à
l'expérimentation et l'analyse des résultats,
sauf la transcription des entrevues qui sera confiée
à une secrétaire. Un professionnel de la
Télé-université, possédant de
l'expérience dans ce type d'entrevues, avec laquelle
les membres de l'équipe ne sont pas familiers, agira
comme personne-ressource. Le responsable du projet
supervisera l'ensemble des travaux et rédigera le
rapport de recherche.
|